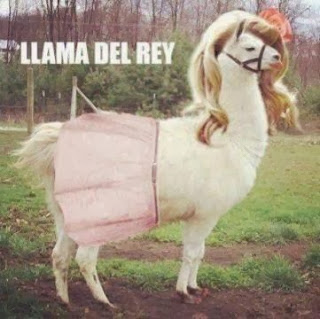Ce dilemme a été imaginé en 1967 par
Philippa Foot dans un article célèbre à propos du problème de l’avortement.
Joshua Greene y a introduit des éléments empiriques; voici la situation que le
dilemme "actualisé" met en jeu :
- Un wagon dévale une pente à vive allure car ses
freins sont hors-d’usage.
- Plus bas sur la voie travaillent cinq ouvriers
qui vont être écrasés, d’autant qu’il n’y a aucun moyen de les
prévenir.
- Toutefois, un aiguillage permettrait de faire aller le wagon
sur une autre voie où un seul ouvrier travaille.
- Quelqu’un, qu’on
appellera Denise, a la possibilité d’actionner cet aiguillage. A-t-elle
le droit de le faire ?
- 85% des personnes interrogées affirment qu’elle en a le droit. Cela ne
surprend pas vraiment : ne vaut-il vaut pas mieux qu’une seule personne
meure plutôt que cinq ?
On change maintenant le scénario :
- Le wagon dévale la pente, mais il n’y a aucun aiguillage.
- Toutefois, un
individu nommé Frank se trouve sur une passerelle qui enjambe la voie, à
côté d’un homme suffisamment gros pour que, si Frank le pousse et qu’il
tombe sur la voie, son corps arrête le wagon et l’empêche de poursuivre
sa route meurtrière.
- A-t-il le droit de le faire ?
- Cette fois, 88% des
mêmes personnes interrogées nient qu’il en ait le droit, alors même
qu’ainsi une seule personne mourrait plutôt que cinq, tout comme dans le
cas précédent.
Cette histoire est déroutante, car les mêmes personnes répondent
différemment alors que la situation paraît moralement analogue et que le
résultat est identique : un mort au lieu de cinq.
Comment expliquer cette différence ?
L’éthique normative* contemporaine est marquée par un débat entre deux positions antagonistes:
- le déontologisme ( (notamment la morale kantienne **) théorie éthique qui affirme que chaque action humaine doit être jugée
selon sa conformité (ou sa non-conformité) à certains devoirs) &
- l’utilitarisme (doctrine éthique
qui prescrit d'agir (ou ne pas agir) de manière à maximiser le
bien-être global de l'ensemble des êtres sensibles.
C'est une forme de conséquentialisme: théorie évaluant une action (ou une règle) uniquement en fonction de ses conséquences escomptées)
* L'éthique normative est en philosophie, la branche de l'éthique qui forme des théories permettant d'évaluer moralement les personnes et leurs actions selon des critères de justice et de bien. Le débat central de l'éthique normative est celui qui oppose l'éthique de la vertu.
** Une réponse déontologiste invoque une norme à laquelle l’action ou le
comportement doivent se conformer, norme qui s’énonce généralement comme
une obligation ou une interdiction catégoriques.
Chez
Kant, la norme de non-instrumentalisation de la personne humaine est qu'on
doit se comporter en toute situation en traitant les personnes
concernées comme des fins en soi et non comme de purs moyens.
Ce débat est resté jusqu’à récemment un débat usant d’arguments, d’objections, de contre-exemples et d’expériences de pensée essentiellement conceptuels. Il y a peu cependant, dans la foulée des progrès de l’imagerie cérébrale,
Joshua Greene y a introduit des éléments empiriques : proposant à des sujets différents dilemmes, dont
le dilemme du wagon fou (trolley problem), il a examiné comment leur cerveau réagissait.
Joshua Greene en a tiré
la conclusion que le
déontologisme s’appuyait sur des réponses émotionnelles, alors que l’
utilitarisme utilisait des circuits rationnels, ce qui assurait à ce dernier une meilleure pertinence morale.
Les raisons déontologistes seraient même des rationalisations a posteriori, voire des
confabulations (
Trouble de la mémoire se manifestant comme une fabulation dite « compensatrice » des lacunes amnésiques).
Malheureusement, si le recours à des données empiriques est un progrès philosophique dans l’examen de ces questions, les conséquences que Greene en tire ne semblent pas probantes ...